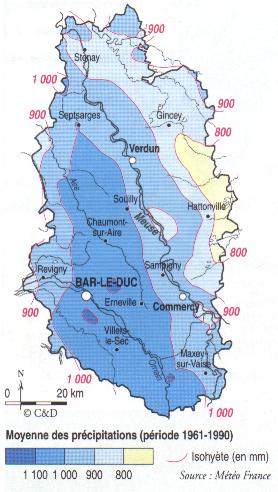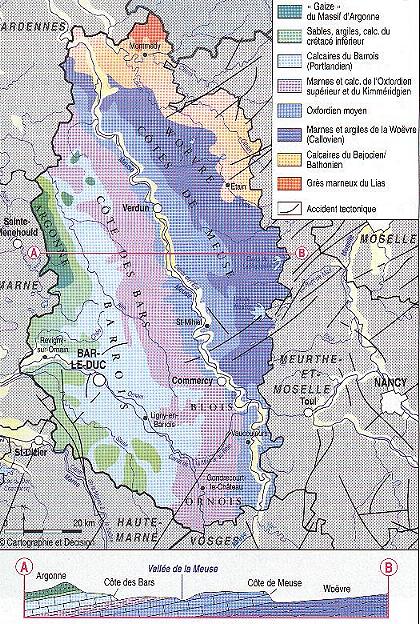|
GEOGRAPHIE
|
Cliquez sur la carte pour l'agrandir

HYDROGRAPHIE ET RELIEF
Le réseau hydrographique meusien est partagé entre trois bassins
versants d’importance très inégale, disposés en
bandes obliques :
 à
l’ouest, le bassin versant de la Seine couvre 2 540km²,
soit 40 % du département; il est représenté par l’Aire,
qui parcourt une ligne droite de plus de 100 kilomètres dans les plateaux
du Barrois et au pied de l’Argonne, et à l’extrême sud-ouest
du département par le duo Ornain-Saulx, affluents de la Marne;
à
l’ouest, le bassin versant de la Seine couvre 2 540km²,
soit 40 % du département; il est représenté par l’Aire,
qui parcourt une ligne droite de plus de 100 kilomètres dans les plateaux
du Barrois et au pied de l’Argonne, et à l’extrême sud-ouest
du département par le duo Ornain-Saulx, affluents de la Marne;
 à
l’est, le bassin du Rhin mord sur la plaine de la Woëvre;
prenant leur source au pied des Côtes de Meuse, l’Orne, le Longeau
et le Rupt de Mad y drainent un espace de 860 km² piqué de nombreux
étangs (soit 15% du département);
à
l’est, le bassin du Rhin mord sur la plaine de la Woëvre;
prenant leur source au pied des Côtes de Meuse, l’Orne, le Longeau
et le Rupt de Mad y drainent un espace de 860 km² piqué de nombreux
étangs (soit 15% du département);
 enfin,
avec 150 kilomètres d’un tracé en écharpe développé
du sud-est vers le nord-ouest, le bassin du fleuve Meuse couvre
45 % du département, auquel il donne son nom. Pincé entre les
bassins voisins qui l’ont, voici très longtemps, dépouillé
de la Moselle et de l’Aire, ce bassin versant bénéficie de
peu d’affluents, sauf au nord où il s’élargir par le
trio de la Chiers, du Loison et de l’Othain. Autrefois renforcée
par les eaux de la Moselle, la Meuse a façonné dans les Hauts
de Meuse une puissante vallée encaissée, égrenant de grands
méandres. Son fond plat, parcouru par le cours sinueux du fleuve, est
encadré par les replats des anciennes terrasses alluviales. La vallée
dégage en outre des éperons rocheux où se sont fixées
les villes (Saint-Mihiel, Verdun, Dun-sur-Meuse), étapes d’un sillon
fluvial qui fut longtemps un important couloir de commerce.
enfin,
avec 150 kilomètres d’un tracé en écharpe développé
du sud-est vers le nord-ouest, le bassin du fleuve Meuse couvre
45 % du département, auquel il donne son nom. Pincé entre les
bassins voisins qui l’ont, voici très longtemps, dépouillé
de la Moselle et de l’Aire, ce bassin versant bénéficie de
peu d’affluents, sauf au nord où il s’élargir par le
trio de la Chiers, du Loison et de l’Othain. Autrefois renforcée
par les eaux de la Moselle, la Meuse a façonné dans les Hauts
de Meuse une puissante vallée encaissée, égrenant de grands
méandres. Son fond plat, parcouru par le cours sinueux du fleuve, est
encadré par les replats des anciennes terrasses alluviales. La vallée
dégage en outre des éperons rocheux où se sont fixées
les villes (Saint-Mihiel, Verdun, Dun-sur-Meuse), étapes d’un sillon
fluvial qui fut longtemps un important couloir de commerce.

Etagé entre 115 et 451 mètres d’altitude,
le département, situé sur la bordure orientale du Bassin parisien,
présente une topographie globalement peu marquée. Elle est néanmoins
rythmée par les larges arcs de cercle des reliefs de côte, alternant
avec des plaines et des plateaux, ces derniers particulièrement étendus
et élevés (300-400 mètres) au sud. Trois côtes boisées,
au front tourné et relevé vers l’est, compartimentent l’espace
départemental avec la complicité d’un réseau hydrographique
souvent calé sur les axes des reliefs.
A l’ouest,
le massif de la Côte d’argonne sépare la Lorraine de la Champagne.
Cette puissante barrière rectiligne, perchée à 300 mètres
d’altitude, est brutalement interrompue vers le sud à Seuil-d’Argonne,
où une plaine basse (120-200mètres), en prolongement vers Revigny,
s’y substitue.
De Montfaucon à Gondrecourt, les plateaux du Barrois couvrent le centre
et, sur une étendue de 40 kilomètres, une large partie du sud meusien.
Cette grande table ondulée, entaillée par la Saulx, l’Ornain
et l’Aire, est limitée à l’est par le talus sinueux de la
Côte des Bars, relevé en moyenne à 350 mètres d’altitude.
De Dun-sur-Meuse à Vaucouleurs s’étire, toujours en oblique,
une puissante bande de relief entaillée par le cours de la Meuse. Particulièrement
massifs et bien soulignés de Dun à Saint-Mihiel, où ils portent
le nom de
Hauts de Meuse, ces plateaux boisés sont ourlés à
l’est par l’arc de la Côte de Meuse. Son front imposant, haut de
120 mètres en moyenne, étiré sur plus de 100 kilomètres
et d’où se détachent des buttes et des éperons (Côte
Saint-Germain, Morimont, Éparges, Montsec), atteint régulièrement
400 mètres d’altitude. En contrebas, la plaine de la Woëvre (250
mètres) ferme le département sur sa bordure orientale, alors que sur
les confins nord et nord-est (pays de l’Othain et de Montmédy) émergent
des éléments de plateaux peu marqués.
Carte Physique de la Meuse
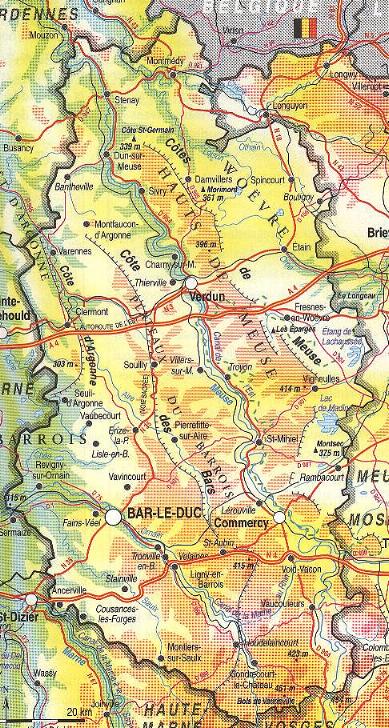
|

CLIMAT ET GEOLOGIE
Ouverte aux influences océanique et continentale,
la Meuse est soumise à un climat tempéré caractérisé
par des saisons thermiques alternées. Le régime des températures
alterne en effet une saison froide et une saison chaude, entre lesquelles s'intercalent
les transitions tièdes du printemps et de l'automne. Si, sous la domination
océanique adoucissante des flux d'ouest, les variations de températures
restent modérées, on peut souligner les épisodes de «
durcissement » climatique introduits sous l'effet de la continentalité
: au coeur de l'hiver, des coulées d'air polaire, installées par un
anticyclone froid, induisent un gel fort et prolongé parfois renforcé
par un vent de nord-est. Ces journées glaciales, mais aux cieux limpides
et ensoleillés, contrastent avec la canicule régulière d'un
été souvent assez court.
Ce régime thermique caractérise donc un climat de type océanique
dégradé à nuances continentales.
Le volume annuel des précipitations s'établit, en
moyenne, à 900 millimètres. Mais ces valeurs, habituelles dans les
plaines et les collines du Bassin parisien, présentent des disparités
à l'intérieur du département : l'est et le nord de la Meuse
sont souvent en dessous de 850 millimètres, tandis que les plateaux centraux
du Barrois en reçoivent plus de 1000.
Cet apport pluviométrique, étalé pour l'essentiel
sur 150 à 200 jours, connaît son maximum absolu en saison froide, avec
des épisodes neigeux. Une pointe de précipitations au printemps et
le creux peu marqué de l'été, souvent orageux, soulignent encore
le « gauchissement , climatique imposé par la continentalité.
Précipitations moyennes
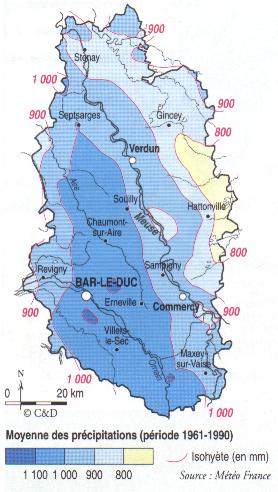
|

Mordant sur la bordure orientale du Bassin parisien, le
département de la Meuse est assis sur des terrains sédimentaires.
Ils relèvent, hormis la pointe nord (Lias marno-gréseux du Pays de
Montmédy) et les confins champenois (Crétacé), du jurassique
moyen et supérieur. Relevés vers l'est dans le cadre d'une structure
monoclinale, ces grands arcs de cercle chronologiquement empilés, des plus
anciens à l'est aux plus récents à l'ouest, se sont mis en
place sur 60 millions d'années.
L’apparente simplicité de la stratigraphie et de la
lithologie, alternant des niveaux calcaires et des niveaux argilo-marneux, doit
cependant compter avec de fréquentes modulations d'épaisseurs et des
variations verticales et latérales dans les faciès des roches, induisant
dès lors un véritable millefeuille lithologique. Ce sous-sol varié
a fait l'objet, au cours des Siècles, d'une intense exploitation : argile
de poterie et tuilerie, sables de verrerie et de fonderie, nodules phosphatés
dans le Crétacé, pierre de taille et pierre à chaux dans les
assises calcaires du jurassique, minerai de fer à la base du Bajocien.

Une lithologie variée
Au nord-est, le Bajocien-Bathonien, présente des calcaires
oolithiques et récifaux, intercalés d'épais niveaux marneux
dans le Bathonien. Ce dernier s'achève localement (Étain) par une
dalle calcaire. L’arc de la Woëvre est appuyé sur les marnes et
argiles du Callovien, intercalées avec des épisodes calcaires et gréseux.
Il jouxte les épaisses assises calcaires de l'Oxfordien moyen et supérieur
qui empilent des faciès vaseux ou à entroques et sont lardées
par de puissantes lentilles de calcaires récifaux. Cette épine dorsale
carbonatée vient mourir à l'est en plongeant sous le millefeuille
marno- calcaire du Kimméridgien.
Le Portlandien achève la série Jurassique. Il disparaît
vers le nord à hauteur de Montfaucon. Finement stratifié au nord de
l’Aire, cet ensemble calcaire et marneux est porté au sud par des assises
de calcaires durs et compacts (pierre châline, oolithe de Savonnières).
Plaqué sur la surface d'érosion qui tronque en biseau
les « calcaires portlandiens du Barrois », le Crétacé offre
une dissymétrie stratigraphique et lithologique nord-sud. En Argonne, il
empile de fins placages d'argiles et de sables verts surmontés par le grès
siliceux de la Gaize, faciès épais de 90 mètres qui s'efface
au sud de Seuil-d'Argonne. Au sud, la stratigraphie complète superpose un
complexe d'argiles, de sables et de calcaires.

La dynamique géomorphologique
du relief de côte
Cette alternance répétée de roches dures
(calcaires) en binôme avec des roches tendres (argiles, marnes) détermine
des contrastes de résistance étagés d'ouest en est du département.
Un empilement géologique, visible sur la coupe, est soumis par ailleurs à
un pendage, c'est à dire une pente des couches rocheuses, relevées
vers l'Est.
Dans ces conditions, le travail de l'érosion différentielle
sur ces binômes a dégagé des fronts de cuesta ou reliefs de
côte. Armés par des assises dures qui se prolongent sur les plateaux
de revers, ils dominent des plaines excavées dans les niveaux tendres. Les
conditions géologiques et structurales d'ensemble ont ainsi déterminé
l'organisation générale des reliefs, tandis que les formes de détails
du modelé reposent sur les données locales des faciès et de
la micro-structure.
Le réseau hydrographique a largement retouché
ce dispositif, en incisant les plateaux et en ménageant à
travers les cuesta de larges percées en entonnoir. Il se manifeste aussi de
manière souterraine, dans le cadre de réseaux karstiques développés
dans les calcaires du Portlandien (bordure de l'Argonne et Barrois) et du Bajocien-Bathonien.
Schéma géologique
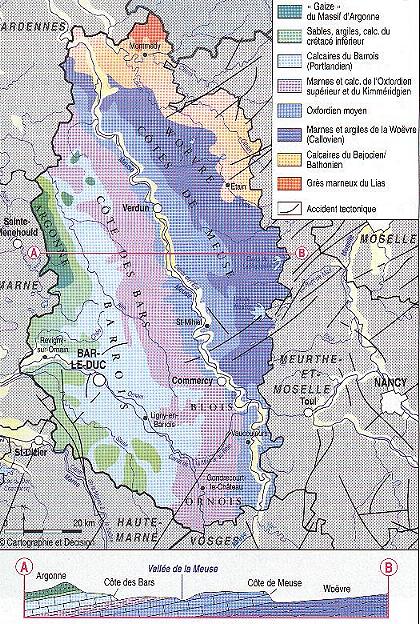
|

ENVIRONNEMENT
Ornois, Blois, Argonne, Pays de Montmédy, Woëvre,
Barrois, Verdunois, Val de Meuse, Pays aux Bois... : micro-régions naturelles,
découpages introduits par l'histoire, simples reliques de la toponymie ou
récentes entités économiques, ces petits pays inscrits dans
l'espace meusien traduisent en critères variés sa grande diversité
de détail. Ils expliquent aussi la force d'unité qui, depuis 1790,
rassemble ces éléments épars et souvent divergents au sein
d'un département d'abord appelé «Barrois» puis finalement
nommé du fleuve qui le fend de part en part. La Meuse «ainsi logée,
commençait d’être».
Cette riche palette de pays ne trouve pas de transcription paysagère
aussi variée. Depuis trente ans, les paysages des « pays » sont
en effet sous l'action des remembrements, des nouvelles pratiques agricoles ou des
aménagements du bâti comme de la voirie, progressivement « lissés
» et homogénéisés. Par ailleurs, les paysages de ce département
à dominante agricole et forestière sont globalement déterminés
par les grandes unités naturelles qui alternent, avec un rythme régulier
et une trame massive, plateaux, « côtes » et plaines.
Les fronts linéaires de l'Argonne, de la Côte des
Bars et de la Côte de Meuse sont soulignés par d'épais manteaux
boisés. Débordant sur les plateaux des arrières côtes
(Hauts de Meuse et Pays aux Bois, Barrois), ces forêts ont souvent été
trouées par des défrichements agricoles. Au pied des côtes meusiennes
jalonnées de nombreux villages, s'étalent les paysages de la vigne
et de l'arboriculture (mirabelliers).
À l'est, la Woëvre s'impose comme une épaisse
bande de plaine humide en avant de la Côte de Meuse. Jonchée d'étangs
piscicoles anciennement aménagés par les moines et de vastes forêts,
son paysage porte aujourd'hui le damier agricole de la grande culture.
Formant un duo de vallées parallèles, la large et
douce gouttière de l'Aire et le profond sillon de la Meuse offrent des paysages
ouverts et faiblement boisés. Les fonds de vallée humides restent
voués aux prairies, tandis que les bordures sont le domaine de la polyculture.
Les vallées de la Meuse et de l'Ornain ont, en outre, fixé de modestes
noyaux urbains et industriels.
Enfin, la Meuse conserve, dans le périmètre de ses
champs de bataille 1914-1918, l'empreinte de « polémo-paysages »,
dévastés par les bombardements et les explosions de mines et devenus
aujourd'hui des lieux de la mémoire collective européenne.
Pingouin production-1998 


![]() à
l’ouest, le bassin versant de la Seine couvre 2 540km²,
soit 40 % du département; il est représenté par l’Aire,
qui parcourt une ligne droite de plus de 100 kilomètres dans les plateaux
du Barrois et au pied de l’Argonne, et à l’extrême sud-ouest
du département par le duo Ornain-Saulx, affluents de la Marne;
à
l’ouest, le bassin versant de la Seine couvre 2 540km²,
soit 40 % du département; il est représenté par l’Aire,
qui parcourt une ligne droite de plus de 100 kilomètres dans les plateaux
du Barrois et au pied de l’Argonne, et à l’extrême sud-ouest
du département par le duo Ornain-Saulx, affluents de la Marne;![]() à
l’est, le bassin du Rhin mord sur la plaine de la Woëvre;
prenant leur source au pied des Côtes de Meuse, l’Orne, le Longeau
et le Rupt de Mad y drainent un espace de 860 km² piqué de nombreux
étangs (soit 15% du département);
à
l’est, le bassin du Rhin mord sur la plaine de la Woëvre;
prenant leur source au pied des Côtes de Meuse, l’Orne, le Longeau
et le Rupt de Mad y drainent un espace de 860 km² piqué de nombreux
étangs (soit 15% du département);![]() enfin,
avec 150 kilomètres d’un tracé en écharpe développé
du sud-est vers le nord-ouest, le bassin du fleuve Meuse couvre
45 % du département, auquel il donne son nom. Pincé entre les
bassins voisins qui l’ont, voici très longtemps, dépouillé
de la Moselle et de l’Aire, ce bassin versant bénéficie de
peu d’affluents, sauf au nord où il s’élargir par le
trio de la Chiers, du Loison et de l’Othain. Autrefois renforcée
par les eaux de la Moselle, la Meuse a façonné dans les Hauts
de Meuse une puissante vallée encaissée, égrenant de grands
méandres. Son fond plat, parcouru par le cours sinueux du fleuve, est
encadré par les replats des anciennes terrasses alluviales. La vallée
dégage en outre des éperons rocheux où se sont fixées
les villes (Saint-Mihiel, Verdun, Dun-sur-Meuse), étapes d’un sillon
fluvial qui fut longtemps un important couloir de commerce.
enfin,
avec 150 kilomètres d’un tracé en écharpe développé
du sud-est vers le nord-ouest, le bassin du fleuve Meuse couvre
45 % du département, auquel il donne son nom. Pincé entre les
bassins voisins qui l’ont, voici très longtemps, dépouillé
de la Moselle et de l’Aire, ce bassin versant bénéficie de
peu d’affluents, sauf au nord où il s’élargir par le
trio de la Chiers, du Loison et de l’Othain. Autrefois renforcée
par les eaux de la Moselle, la Meuse a façonné dans les Hauts
de Meuse une puissante vallée encaissée, égrenant de grands
méandres. Son fond plat, parcouru par le cours sinueux du fleuve, est
encadré par les replats des anciennes terrasses alluviales. La vallée
dégage en outre des éperons rocheux où se sont fixées
les villes (Saint-Mihiel, Verdun, Dun-sur-Meuse), étapes d’un sillon
fluvial qui fut longtemps un important couloir de commerce.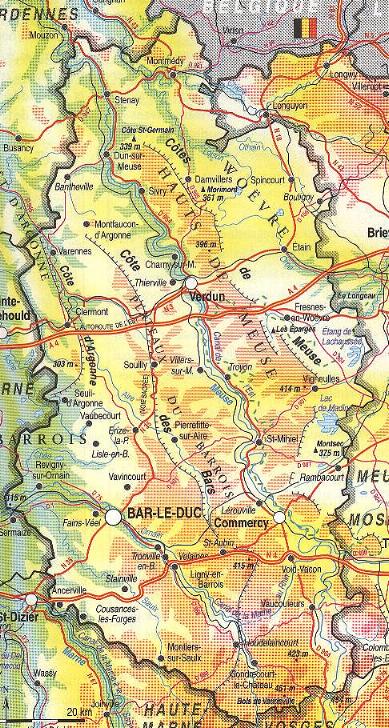
![]()