|
| |
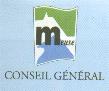
| |
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Au terme d’une longue démarche d’analyse,
de concertation, de consultation, la Meuse de 2015 se dessine, prend des formes
et des couleurs. Le projet que les Meusiens ont voulu pendant l’année
1996 est là sous nos yeux. Les Chambres consulaires, le Conseil Général
et les partenaires socioprofessionnels et associatifs, présentent dans ce
qui suit, la quintessence de ce dossier.
« A quoi ressemblera la Meuse en 2015
? » se demandaient les signataires de l’opération à
ses débuts... En un mot, « aura-t-elle su valoriser ses atouts et permettre
à chacun de profiter de la qualité de vie à laquelle il aspire
? »
« Meuse 2015 » est un plan
de développement qui s’est fondé sur le rapprochement des bonnes
volontés de tous les Meusiens, de l’expertise des socioprofessionnels,
de la volonté des forces politiques.
Les projets phares qui sont présentés
ici sont le fruit du consensus : ils peuvent, ils doivent faire que la Meuse d’ici
vingt ans, la Meuse de nos enfants, soit accueillante à tous les projets,
une terre vivante.
Retenons ce qui fait l’originalité de
ce projet une ambition, 7 commissions correspondant à 7 thèmes couvrant
la totalité des problématiques meusiennes, une commission de coordination,
mais surtout la possibilité d’écouter toutes les idées,
toutes les suggestions de tous les acteurs engagés à un titre ou un
autre.
L’écoute directe des citoyens n’a
pas pour autant été négligée : un sondage confié
à l’IFOP a permis d’une part de sensibiliser les habitants à
la démarche et d’autre part de connaître leurs avis.
En décembre 1996, aboutissement
provisoire de ce processus d’un an des axes de développement sont proposés
et les projets les plus structurants identifiés pour être rapidement
mis en chantier. C’est le départ, au travers d’une collaboration
étroite de tous les acteurs, pour des réalisations de vaste dimension.
Le plan de développement « Meuse 2015
» devait tracer, en préalable, l’état des lieux, le portrait
de la Meuse actuelle. Nous ne reviendrons pas sur la description détaillée
de l’économie du département. Nous en retiendrons quelques affirmations
fortes comme celle du titre qui justifie l’urgence de la réflexion prospective
: « briser la spirale du déclin ».
La Meuse est située dans la « diagonale
aride », celle du vide qui balafre toute l’Europe, de l’Allemagne
du Nord à l’Espagne. Elle peut néanmoins tirer parti de sa proximité
de la « banane bleue », ou des aires « mégalopolitaines »
(Europe du Nord-Ouest et Paris), là où se concentrent les activités
fortes de l’Europe. La Meuse peut être le lieu du desserrement des activités
qui ne trouvent plus de place dans les mégalopoles de le patrimoine peut
asseoir une démarche de développement local l’espace rhénan
ou de la région parisienne : du terrain, de l’air, du calme, de la tranquillité
physique et sociale.
Elle constitue un élément fondamental
: le développement de la Meuse sera d’autant plus efficace et pertinent
qu’il aura su s’articuler avec les exigences rurales d’un département
qui ne doit pas rompre avec ses racines. Grâce à l’agriculture,
le monde rural vit et témoigne d’une spécificité porteuse
d’avenir.
Compte tenu des potentialités et au-delà
des nécessaires restructurations, l’économie semble tout à
fait capable de surmonter certains handicaps. Il s’agit de « négocier
», le plus idéalement possible, le tournant actuel pour briser le cercle
vicieux auto-alimenté par deux composantes essentielles : le chômage
et la dépopulation.
Si la Meuse enregistre des statistiques relativement
plus favorables que dans le reste de la Lorraine et de la France, les chiffres sont,
en fait, peu satisfaisants : c’est parce que les jeunes quittent le département
que les taux de chômage sont plus faibles. Lorsqu’on sait que ce sont
les services qui sont les activités les mieux placées pour créer
des emplois que ne génèrent plus l’agriculture ou l’industrie,
et connaissant notre retard dans ce secteur, on ne peut légitimement que
s’inquiéter. Avec le départ des jeunes, c’est tout le dynamisme
meusien qui est menacé. La Meuse veut réagir elle sera à nouveau
attractive pour les entreprises lorsqu’elle présentera une structuration
urbaine forte, avec des voies de communication adaptées aux échanges
modernes. Le département doit être à même de produire
et de garder des jeunes ayant un niveau de qualification élevé. Les
efforts entrepris doivent être poursuivis.
La Meuse a été marquée par
l’évolution générale de la population française,
mais aussi par le choc des guerres. L’absence de centres urbains forts et le
manque de dynamisme des secteurs industriels et des services ne nous ont pas mis
en situation d’absorber le surplus de demandes d’emploi qui émanait
de l’ancienne population rurale. Or, les entreprises ont besoin de population
autour d’elles (main d’oeuvre, services, clientèle), du moins celles
qui vivent en marché local. La solution meusienne passe, entre autres, par
l’accueil d’entreprises qui visent un marché national et international,
et qui trouveront en Meuse des conditions idéales de production pour vendre
au niveau européen. Elle passe aussi par l’aide à la création
de PME, grâce à un appui au financement, par l’appel à
une épargne de proximité.
Depuis la charte économique signée
en 1984 entre le Conseil Général et les Chambres consulaires, l’aménagement
du territoire est une constante de la politique meusienne. Quatre grands chantiers
ont été ouverts et sont tous en passe d’être réussis
:
C’est à partir des projets des pays
de Meuse que s’établit la planification départementale dans un
partenariat interactif avec le Conseil régional, l’État et l’Union
européenne. Enfin, le tableau ne serait pas complet sans le rappel des efforts
fait pour développer l’enseignement supérieur depuis 1987 : DEUG
(Diplôme d’Etudes Universitaires Générales), IUFM (Institut
Universitaire de Formation des Maîtres), IAE (Institut d’Administration
des Entreprises)
Outre M. Félix DAMETTE, qui a placé
la Meuse dans le système urbain au niveau français et européen,
Mme Christiane ROLLAND-MAY a donné un point de vue non meusien d’aménageur
et d’universitaire.
1) Les cantons polarisés et équilibrés.
Autour de villes, de bourgs industriels, de communes de banlieue avec un dynamisme
humain important : ils peuvent être des points d’appui du développement
meusien;
2) Les cantons fermés organisés,
ruraux, repliés sur un bourg, autrefois prospère, mais aujourd’hui
en crise. La densité est faible et leur écroulement pourrait être
la fin de l’espace meusien;
3) Les cantons ouverts, avec défaillance
des centres urbains. Ruraux, enclavés et peu structurés ou déstructurés,
ils sont des zones de fuite et d’éparpillement. De leur destin, positif
ou négatif, dépend la stabilité territoriale de la Meuse.
Le diagnostic posé sur le « système
Meuse » par le Centre de recherche pour l’information économique
et sociale (CRIES) et Mme ROLLAND-MAY, nous décrit une Meuse devant impérativement
organiser le territoire, et lui donner une cohérence globale. La ville, isolée
ou en réseau, ne devra jamais être absente de la réflexion prospective
de la Meuse de demain : elle sera l’un des points d’appuis majeurs des
stratégies de construction.
Autour de trois schémas d’organisation
du territoire, Mme ROLLAND-MAY propose une logique d’ouverture, et non une
stratégie de repli et de confinement :
La Meuse doit se placer dans une logique audacieuse
de rupture, ce qui est résumé dans la formule : «
esprit meusien, esprit pionnier ». Avec des stratégies novatrices
en matière de communication, de télécommunication, de formation,
de visio-formation, d’accès à distance aux connaissances, à
la culture et aux loisirs.
Difficile de présenter en raccourci
les trois scénarios pour la Meuse de 2015. Ils ont été
établis à partir des indicateurs statistiques rassemblés pour
cette étude et dont les variations possibles ont donné des projections,
pour voir ce qu’il se passerait d’ici vingt ans si...
Les responsables de « Meuse 2015 » pensent
avec réalisme que le deuxième scénario est possible :
il correspond à des politiques engagées ou à engager volontairement,
qui ne porteront effet que plus tard; il table sur une continuation des tendances
régressives actuelles à moyen terme, suivie d’un redressement
qui se prolongera jusqu’en 2015.
La Meuse sait qu’elle ne maîtrise pas
les environnements économiques mondiaux, nationaux, régionaux. Mais
elle pense que l’effort des acteurs locaux doit permettre de rompre le cercle
vicieux et que leur efficacité deviendra tangible au moment où la
spirale du déclin sera muée en spirale vertueuse.
Un autre intérêt de ces scénarios
est de détailler les « variables de commande » face à
un problème, selon l’action et les moyens mis en oeuvre, le résultat
conduit vers l’un ou l’autre des scénarios. Les moyens d’actions
envisagés sont nombreux : ils représentent la partie la moins visible
de la démarche « Meuse 2015 » et néanmoins la plus importante
puisqu’elle analyse les points de blocage à lever et les points forts
à accentuer.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|